La protection ouvrière au 19e siècle
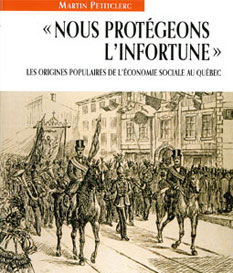 Un récent ouvrage, « Nous protégeons l'infortune », les origines populaires de l'économie sociale au Québec, de Martin Petitclerc, vient montrer l'importance et l'intérêt des sociétés de secours mutuels au Québec dans la seconde partie du 19e siècle.
Un récent ouvrage, « Nous protégeons l'infortune », les origines populaires de l'économie sociale au Québec, de Martin Petitclerc, vient montrer l'importance et l'intérêt des sociétés de secours mutuels au Québec dans la seconde partie du 19e siècle.
EN 1850, la ville de Montréal était déjà le principal centre économique de la colonie, choisie de préférence à Québec par les bourgeois d'affaires anglo-protestants. Pourtant, on n'y trouvait pas encore de véritable industrie manufacturière. Quelques ateliers de la chaussure et du textile ouvrirent leurs portes dans les décennies suivantes, mais sans jamais dépasser cinq cents employés.
La condition ouvrière n'en était pas moins déplorable, car l'immigration irlandaise et l'exode rural avaient déjà fait venir en ville une population déracinée, sans emploi, affrontée à une misère bien réelle. Les œuvres de charité, absorbées par le soin des déshérités de toutes sortes, étaient saturées et ne pouvaient veiller sur les intérêts des ouvriers.
Les institutions de prévoyance financière – banques d'épargne ou compagnies d'assurances – ne répondaient pas non plus à leurs besoins pressants.
À Montréal, les banques d'épargne existaient depuis 1817, et l'une d'elles fut même créée par Mgr Bourget en 1846. Cependant, elles se révélèrent, dans leur principe même, tout à fait inadaptées, surtout lorsque les conditions de vie des ouvriers s'aggravèrent avec la « révolution industrielle » que connut le Québec, après 1880, c'est-à-dire après le développement du chemin de fer. En effet, pour ces gens qui vivaient au jour le jour, dans la crainte d'une mise à pied, d'un accident ou d'une maladie qui les eût privés de leur salaire, l'idée d'une sécurité financière acquise à long terme, à force d'une épargne toujours plus problématique, n'avait rien de séduisant. Ils avaient besoin d'une protection immédiate et sûre.
Par ailleurs, faute de pouvoir payer régulièrement des primes trop élevées, ils ne pouvaient non plus profiter des services offerts par les compagnies d'assurances. Les ouvriers se tournèrent donc vers une solution vraiment adaptée à leur situation : la société de secours mutuels.
UNION SAINT-JOSEPH DE MONTRÉAL
Tout commença après le grand incendie de Montréal en 1852, qui ravagea le tiers de la cité. Aussitôt maçons, charpentiers, tailleurs de pierre, et tous les autres corps de métiers de la construction, furent massivement mobilisés pour rebâtir la ville en toute hâte. Les conditions de travail en souffrirent et les accidents se multiplièrent.
C'est dans ce contexte que se développa la première société de secours mutuels canadienne-française, l'Union Saint-Joseph de Montréal. Celle-ci avait été fondée en 1851, de façon tout à fait spontanée – du moins au dire de ses membres –, par quelques ouvriers tailleurs de pierre : « Dans la dure saison de l'hiver un honnête ouvrier se trouvant à bout de ressource, par cause de maladie, il ne lui restait que l'espoir dans la générosité de ses compagnons d'atelier. Ses espérances ne furent point vaines, il reçut d'eux des secours, ce qui donna à l'un de ces hommes l'idée de former une société telle que celle dont nous avons l'honneur de vous parler aujourd'hui, et dont déjà plusieurs de ses membres ont pu apprécier les bienfaits. »
Deux années plus tard, en 1853, la Société grandissante voulut s'ouvrir à tous les métiers : plusieurs membres s'y opposant, il en résulta une scission d'où sortirent deux nouvelles sociétés mutuelles, organisées par métiers : l'Association des menuisiers-charpentiers de Montréal et la Société des tailleurs de pierre de Montréal, qui donna naissance en 1857 à l'Union Saint-Pierre de Montréal. Ces trois sociétés constituèrent pendant près d'une décennie le premier noyau mutualiste canadien français.
En 1854, l'Union Saint-Joseph, réduite à une centaine de membres du fait de la scission, fit tout de même un énorme effort pour solenniser sa fête patronale dans une manifestation publique. Le lundi 20 mars 1854, les membres se regroupèrent devant leur local, en ordre de défilé. En tête, six ouvriers portaient une énorme bannière, achetée 24 livres aux Sœurs Grises et frappée de ces mots : « Union Saint-Joseph de Montréal. Nous protégeons l'infortune ». Au deuxième rang suivaient le drapeau britannique et la fanfare, engagée pour l'occasion. En dernier lieu venaient les administrateurs de la société, en uniforme, et le reste des membres. Le cortège traversa la ville, jusqu'à l'église Saint-Pierre, où fut chantée une messe solennelle de 1re classe. La quête fut faite par les dames de la Société et son produit fut distribué aux œuvres de charité. Le défilé reprit son cours jusqu'au local de l'association, où l'on avait dressé un banquet et préparé une petite fête.
Cette manifestation, répercutée par la presse, devait en entraîner d'autres, de plus en plus fastueuses chaque année : elle marque le début d'un véritable mouvement mutualiste, qui devint un fait de société au Canada français. D'abord assez circonscrit à la région de Montréal, le mouvement s'étendit ensuite au reste de la province. Ainsi, de nouvelles “ unions Saint-Joseph ” virent le jour à L'Industrie (1860), Saint-Michel de Sorel (1860), Joliette (1861), Ottawa et Saint-Jean d'Iberville (1863), Trois-Rivières (1864), Québec et Lévis (1865)… Le plus souvent, leurs statuts étaient simplement calqués sur ceux de la société mère de Montréal, représentative de tout le mouvement.

lors du défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 1895.
LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
Au principe de la mutualité, il y a l'association spontanée de quelques ouvriers qui promettent de s'épauler dans le malheur. Cette entraide prit donc rapidement la forme d'une petite caisse commune, réservée pour les mauvais jours et pour les nécessités individuelles. Par exemple, sur cette caisse, l'Union prélevait 3 $ par semaine pour l'ouvrier en détresse privé de son salaire. S'il venait à mourir, on payait cette somme à la veuve, avec un supplément de 1,50 $ jusqu'à son remariage. On y ajoutait aussi la couverture des frais funéraires et une petite pension pour les orphelins.
Les cotisations des membres étaient la seule ressource financière de la mutualité, question de principe car les ouvriers ne voulaient pas dépendre de la charité publique, mais uniquement de leur travail ! À la différence des compagnies d'assurances, les cotisations étaient égalitaires, afin de ne pas pénaliser les sujets de santé fragile ou de moindre aptitude professionnelle : les nouveaux membres n'avaient donc pas à se soumettre à un examen médical ou à une évaluation des risques. En revanche, le montant des cotisations pouvait varier selon les besoins immédiats de la société, ce qu'acceptait chaque membre lors de son adhésion.
L'avantage financier était incontestable : pour une protection équivalente, l'Union Saint-Joseph faisait payer le tiers du prix fixé par une compagnie d'assurances montréalaise de la même époque.
Cependant, le caractère le plus séduisant de la formule mutualiste était ailleurs, dans l'encadrement relationnel qu'il apportait aux ouvriers déracinés de la campagne. Un petit trait parmi tant d'autres le montre bien : « Octave Renaud tomba dangereusement malade ; cet homme était pauvre et n'avait pu payer ses contributions qui lui auraient donné droit au bénéfice de la Société. M. Bastien proposa une collecte pour payer les arrérages de M. Renaud : aussitôt dit, aussitôt fait. Quelques jours après, M. Renaud meurt, il est enterré aux frais de la Société, et sa veuve retire depuis plusieurs années l'allocation qu'elle doit au bon mouvement de M. Bastien et à la générosité de ses confrères ».
Ainsi, les secours étaient-ils adaptés aux besoins réels des familles en détresse. En cas de maladie, l'Union organisait des visites à domicile. En cas de chômage, elle constituait un réseau d'amis et de connaissances qui aidaient le chômeur à trouver un nouveau travail. Même dans le cadre professionnel, la mutuelle était le lieu d'un partage d'expériences et de connaissances. En 1857, grâce à une subvention, l'Union s'offrit même le luxe d'une bibliothèque de 300 livres à la disposition des membres.
Évidemment, ces sociétés mutuelles étaient à but non lucratif et gérées démocratiquement, sur le modèle des coopératives, où chaque membre étant à la fois propriétaire de la Société et bénéficiaire de ses services, a aussi voix au chapitre pour le choix des administrateurs et l'approbation de leur gestion.
C'est exactement le contraire d'une compagnie d'assurances classique, où la recherche du profit rend contradictoires les intérêts particuliers de l'assureur et de l'assuré, dont les rapports sont forcément réglementés par un contrat. Rien de tel dans une société mutuelle, puisqu'il n'y a, en principe, qu'un seul intérêt commun, celui de la société, auquel sont liés les intérêts individuels de chaque membre. Il n'y a donc pas besoin de contrat, mais d'un engagement général de tous au profit de tous.
Voilà qui semble très proche de notre doctrine communautaire, écologique… Cependant, à y regarder de plus près, ces sociétés mutuelles ont une origine suspecte.
LES ORIGINES OBSCURES DU MOUVEMENT MUTUALISTE
Les ouvriers canadiens français n'ont pas eu la primeur du système de secours mutuels au Canada. En effet, les sociétés secrètes anglo-saxonnes avaient introduit cette pratique dans les milieux professionnels anglophones, dès les années 1840, selon le modèle déjà en vogue en Angleterre.
Il est indubitable que le règlement interne de l'Union Saint-Joseph et de ses sociétés “ filles ”, tenait davantage de la société secrète que de l'association catholique. Les assemblées étaient hermétiques, demandant mot de passe, carte de membre et une sorte de ritualisme suspect. On trouvait aussi parmi les membres des anticléricaux notoires, affiliés à l'Institut Canadien. Cette société philanthropique, fondée en 1844, était en réalité la façade de la franc-maçonnerie au Canada français. Or son cheval de bataille était la création de bibliothèques… prétendument pour promouvoir la culture, mais en fait, pour donner accès aux livres condamnés par l'Église. C'est par ce biais que l'Union Saint-Joseph a pu ouvrir, elle aussi, sa bibliothèque en 1857.
De plus, les assemblées éduquaient les ouvriers à la « démocratie participative », toute décision étant prise en commun, après de longues délibérations. On veillait aussi à la rotation des postes de responsabilité, afin de donner aux ouvriers le goût de l'exercice démocratique et de la contestation. Ainsi, sur les dix sièges du conseil de l'Union se succédèrent soixante-dix-neuf personnes, entre 1852 et 1857 ! Un code de règlements très stricts visait à « renforcer l'esprit de corps », avec amende pour les contrevenants. N'en citons qu'un seul, qui parle de soi : « Tout membre qui introduit dans les débats aucun sujet qui touche à la religion ou à la politique est passible d'une amende de trente sous. »
Derrière le paravent du secours mutualiste et de ses manifestations religieuses – indispensables dans le contexte de renaissance catholique de cette époque, pour attirer et retenir les braves gens –, se profile donc la main de la franc-maçonnerie. Qu'elle ait eu réellement l'initiative du mouvement, ou qu'elle l'ait rapidement infiltré et organisé, elle cherchait, par lui, à rejoindre la population laborieuse canadienne française et catholique, afin de lui insuffler un esprit d'indépendance qui la dégage de l'influence de son protecteur tutélaire : le clergé catholique.
LA RÉACTION DE L'ÉGLISE

Il n'est pas étonnant que Mgr Bourget, évêque de Montréal, ait réagi sans tarder devant cette situation, lui qui, dès 1846, mettait sévèrement en garde son troupeau contre les sociétés secrètes : « La charité de Jésus-Christ (…) nous engage à élever aujourd'hui la voix, pour vous mettre en garde contre certaines sociétés, dans lesquelles on tâche de vous attirer ; sociétés d'autant plus dangereuses qu'elles se couvrent des dehors sacrés de la charité. Et il ne faut pas s'en étonner, puisque le démon, pour mieux tromper les hommes, se transforme en ange de lumière, comme nous en assure l'apôtre saint Paul ». On sait aussi que, dans le même élan, il entreprit une lutte tenace et sans merci contre l'Institut Canadien, jusqu'à obtenir l'excommunication de ses membres par Rome en 1867.
Pour contrer l'influence de l'Institut sur l'Union Saint-Joseph, le zélé pasteur n'était pas sans ressource. Il renouvela l'attitude qu'il avait eue contre les Patriotes anticléricaux, quelques années plus tôt, au sujet des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste. En faisant du 24 juin la “ fête nationale du Canada français ”, ceux-ci avaient voulu se servir du caractère religieux de la fête pour mieux diffuser dans le peuple leurs idéaux démocratiques et révolutionnaires. Mgr Bourget avait alors ordonné à ses curés d'organiser eux-mêmes les festivités. Les belles célébrations religieuses furent maintenues, mais non pas les grands banquets où l'on exaltait les slogans et poncifs de la franc-maçonnerie.
Le cas de l'Union Saint-Joseph fut donc traité de la même façon...
Quand les administrateurs de la Société frappèrent à la porte de l'évêché en 1854 pour organiser leur fête patronale, ils furent bien étonnés de se voir opposer un refus de collaboration. Il fallait, leur fut-il répondu, que la Société modifie ses constitutions sur deux points essentiels : prévoir la présence d'un chapelain à ses réunions, et stipuler l'expulsion des athées ainsi que des membres de sociétés secrètes. En 1856, l'évêque précisa ses exigences. Il s'ensuivit un débat houleux, au terme duquel on décréta : « La motion suggérée par l'évêché est déclarée hors-norme, car elle veut ajouter à notre constitution les mots " catholiques romains " après les mots " canadiens français " qui s'y trouvent, et parce que notre constitution dans un autre endroit défend l'introduction de toute matière religieuse. »
Comme le président de l'Union était alors un certain Ignace Rathé, membre de l'Institut Canadien, Mgr Bourget n'hésita pas à durcir encore sa position. Bien lui en prit : le président perdit son poste en 1857, et l'assemblée donna satisfaction à la requête épiscopale concernant la présence d'un chapelain. Le poste fut aussitôt confié à l'abbé Fabre. Mais peu après, Rathé, soutenu par son clan, reprit le contrôle de la Société. Il en résulta un conflit ouvert entre le chapelain et le président, l'un sommant l'autre de désavouer les manœuvres des ouvriers catholiques contre lui, et Fabre répondant que toute collaboration entre l'Église et la Société était impossible aussi longtemps qu'un membre de l'Institut Canadien en demeurerait président. Cette fois, Rathé fut évincé de son poste pour n'y plus reparaître. Il fut exclu de la Société en 1863 puis, excommunié en 1867 comme tous les autres membres actifs de l'Institut, il alla finir ses jours aux États-Unis.
Mais il fallut encore de longs débats avant que Mgr Bourget n'obtienne entièrement gain de cause, preuve que l'esprit anticlérical était déjà bien diffusé parmi les membres. Ce n'est qu'en 1865 qu'une dernière motion, adoptée à une très forte majorité, mit fin au litige : « La société aura toujours un chapelain qui lui sera donné par les supérieurs ecclésiastiques, et elle verra toujours avec plaisir que soit le chapelain, soit quelques autres messieurs du clergé assistent à ses séances et soient invités à parler pour l'encouragement de la société sur la morale. »
Mgr Bourget était donc parvenu à désamorcer le « système » : les mutuelles ne seraient pas cette entité subversive rêvée par les anticléricaux pour faire pièce à l'influence de l'Église sur la population ouvrière.
Au contraire, après 1867, on compta plusieurs exemples de bonne collaboration entre elles et le clergé, comme à Sherbrooke (1874), où les administrateurs se flattaient de compter parmi leurs membres actifs, pour l'encouragement de la Société, « quatre révérends messieurs du clergé ». Parfois ce fut même le clergé qui eut l'initiative de la mutuelle, notamment à Saint-Hyacinthe, où l'abbé Louis-Zéphyrin Moreau, futur évêque et bienheureux, cherchait explicitement à « prévenir l'embrigadement des ouvriers dans les sociétés secrètes anglo-saxonnes ».
UN MOUVEMENT LAISSÉ À LUI-MÊME
Toutefois, le mouvement mutualiste ne fut jamais encouragé unanimement par le clergé dans l'ensemble de la Province, et il ne devint jamais non plus une œuvre d'Église. Ce qui se comprend très bien. En effet, comme le rappellent nos 150 points, dans le cadre d'une société chrétienne, « il y a tout intérêt à reconnaître à ces associations la plus grande liberté, avant toute intrusion autoritaire et réglementation administrative. Puisque l'équilibre écologique s'y invente et s'y maintient tout seul ! (…) Ainsi ont pu vivre et prospérer de grandes nations, de très hautes civilisations, dans une économie spontanée, moralisée par la religion, protégée par les pouvoirs politiques, mais autogérée, se conservant dans un équilibre général de type humain et non mathématique, naturel et non technocratique, autorégulé et non planifié. Où la vertu de prudence l'emportait sur la loi barbare du profit. »

Cependant, il est indubitable que les mutuelles canadiennes françaises ont manqué d'une direction générale. Pendant plus de quarante ans, le mouvement a grandi dans un désordre complet, sans projet commun, ni vision d'ensemble. C'est bien regrettable, car il ne manquait pas de potentiel. On estime qu'en 1868, il y avait 40 sociétés mutuelles. En 1885, on en comptait 60, et 90, dix ans plus tard. Leurs effectifs variaient de quelques dizaines de membres à mille sept cents pour l'Union Saint-Joseph de Montréal, alors à son apogée. On ne compte pas les sociétés qui apparaissaient et disparaissaient presque dans la même année, sans laisser de traces, faute de direction sans doute.
Plusieurs tentatives de regroupement eurent lieu dans les années 1860, mais elles tournèrent à la campagne électorale et s'abîmèrent dans le tumulte politique entourant la Confédération en 1867. Ce fut le cas, en particulier, de la Confédération des sociétés de secours mutuels catholiques (1862) et de la Grande Association (1865). Cette dernière était l'œuvre de Médéric Lanctôt, un avocat et journaliste, de tendance radicale ; à l'été 1867, il réussissait à rallier plus de dix mille ouvriers qui auraient marché derrière lui comme un seul homme, s'il n'avait été battu aux élections suivantes...
Comme il est regrettable que l'Église, après avoir réussi à éloigner de l'organisation les sociétés secrètes, n'ait pas su prendre leur place pour organiser le mouvement et assurer sa pérennité ainsi que le respect des principes de base !
L'INACTION DE L'ÉTAT
Le plus étonnant, à première vue, c'est que l'État aussi fit complètement défaut. Il n'en était pas de même en Angleterre ni dans les autres provinces canadiennes.
En Angleterre, la législation établit dès 1793 une procédure normale d'incorporation des sociétés mutuelles, leur accordant une personnalité morale et juridique. En 1817, 1819, 1829, une série de mesures veilla à sécuriser leurs placements, à soumettre leurs comptes à un expert et à publier leurs états financiers. En 1846, elle créa un poste de registraire des sociétés mutuelles, chargé de prévenir ou d'arbitrer les conflits. Enfin, en 1855, les mutuelles se virent accorder le droit d'établir, à l'interne, leurs propres procédures judiciaires, ce qui allégeait d'autant leurs procès civils.
Or au Bas-Canada puis au Québec, une seule loi fut promulguée en 1850, dans le but de prévenir les fraudes financières, mais sans accorder la personnalité morale et juridique. Les mutuelles en étaient réduites de ce fait à un simple contrat associatif entre personnes, facilement révocable à la moindre dissension. Ou alors, elles étaient dans l'obligation de se lancer dans une longue procédure, à l'issue incertaine, pour obtenir qu'une loi privée leur accorde la personnalité morale.
Pourquoi une telle différence entre la politique de la Grande-Bretagne vis-à-vis des mutuelles, et celle de son dominion canadien ? En outre, cet ostracisme de l'État ne se retrouve pas dans les autres provinces et, à y regarder de plus près, la loi de 1850 – la seule qui, ici, encourageât le mouvement pendant tout ce siècle – fut promulguée un an avant la fondation de l'Union Saint-Joseph de Montréal, la première mutuelle canadienne française, elle n'était donc destinée qu'aux sociétés fraternelles anglo-saxonnes qui existaient déjà à l'époque. « Le Québec a été l'un des seuls endroits en Occident où les sociétés de secours mutuels ne pouvaient bénéficier, au XIXe siècle, des avantages d'une loi générale d'incorporation », affirme Petitclerc.Une conclusion toute simple en découle : le gouvernement se méfiait d'un mouvement qui, soutenu par l'Église, aurait pu consolider le nationalisme canadien français catholique…
LA CRISE DE LA MUTUALITÉ
Alors, ce qui devait arriver arriva. Le mouvement mutualiste, privé du soutien de l'État, sans cadre légal adéquat, et malheureusement sans le conseil des évêques, périclita.

Au cours des années 1890, les petites sociétés locales déclinèrent lentement pour de multiples raisons : mauvaise gestion, cotisations impayées, escroquerie, concurrence entre sociétés, etc… Souvent aussi, de sombres histoires de jalousies et des dissensions internes entraînaient d'interminables procès qui ternissaient la réputation de la société.
Pour remédier à ces désordres, les mutuelles cherchèrent peu à peu à se placer dans le cadre mieux défini du droit des compagnies d'assurances… avec tous les changements structurels que cela suppose.
C'est là qu'on peut vraiment regretter que l'Église ne se soit pas davantage intéressée à ce mouvement d'entraide ouvrier. Parmi les évêques de la fin du siècle, il n'y eut guère que le bienheureux Mgr Moreau à se préoccuper de la question. C'est d'ailleurs l'Union Saint-Joseph de son diocèse de Saint-Hyacinthe qui eut l'initiative du Congrès des sociétés catholiques de bienfaisance et de secours mutuels, lequel obtint finalement du Gouvernement provincial une loi pour l'incorporation obligatoire des sociétés en 1899. Mais cette législation venait trop tard. En outre, la stricte réglementation qu'elle établissait, si elle pouvait paraître nécessaire, vu le désordre et les abus de l'époque, n'en trahissait pas moins l'équilibre écologique spontané, qui était la caractéristique si appréciable du mouvement en ses débuts. La société d'entraide ouvrière allait donc laisser la place à une autre forme de mutualité.
VERS UNE MUTUALITÉ D'AFFAIRES
Au début des années 1890, en effet, un nouveau courant mutualiste avait déjà commencé à se répandre, celui des sociétés fraternelles d'assurance-vie. L'initiateur de ce mouvement au Québec est Louis Archambault, menuisier entrepreneur de son état, qui fit ses premières armes dans la reconstruction de Montréal en 1852. À l'époque, au tout début du mouvement mutualiste, il avait soutenu de son mieux la mutuelle des menuisiers-charpentiers de Montréal, née de l'Union Saint-Joseph (supra, p. 2). Quand celle-ci s'éteignit, faute de membres, en 1876, il tira les leçons de cet échec et relança le mouvement sur de nouvelles bases. Ce fut la société des Artisans canadiens-français.
 Il semble que Louis Archambault n'ait pas été un vrai disciple de Mgr Bourget. Il suivait beaucoup les conseils de son frère, Urgel-Eugène, un enseignant très dynamique, fondateur de l'école polytechnique de Montréal (1873), qui, dans ses voyages en Europe, avait pu observer chez les Français une conception plus “ professionnelle ” de la mutualité, à laquelle il intéressa son frère. Louis et Urgel-Eugène étaient certes d'excellents catholiques, qui avaient œuvré généreusement sous la houlette du saint évêque de Montréal, le premier à la Société Saint-Jean-Baptiste, dont il fut élu président pour l'année 1876, et le second au Bureau des commissaires d'écoles catholiques romains de la cité de Montréal. Mais, en 1876, Mgr Bourget, démissionnaire, passait le flambeau à son successeur, et l'heure était aux querelles de succession, qui firent souvent le jeu du libéralisme. Les frères Archambault, chacun dans son domaine, ont participé à ce désordre. On vit par exemple Louis prendre sur lui de faire reconduire dans ses fonctions le chapelain de la Société Saint-Jean-Baptiste, au grand déplaisir de Mgr Bourget qui se réservait ce pouvoir. Au même moment, Urgel-Eugène se battait contre la politique de l'ultramontain Boucherville, qui voulait renforcer le monopole de l'Église sur l'enseignement, au détriment des enseignants laïcs...
Il semble que Louis Archambault n'ait pas été un vrai disciple de Mgr Bourget. Il suivait beaucoup les conseils de son frère, Urgel-Eugène, un enseignant très dynamique, fondateur de l'école polytechnique de Montréal (1873), qui, dans ses voyages en Europe, avait pu observer chez les Français une conception plus “ professionnelle ” de la mutualité, à laquelle il intéressa son frère. Louis et Urgel-Eugène étaient certes d'excellents catholiques, qui avaient œuvré généreusement sous la houlette du saint évêque de Montréal, le premier à la Société Saint-Jean-Baptiste, dont il fut élu président pour l'année 1876, et le second au Bureau des commissaires d'écoles catholiques romains de la cité de Montréal. Mais, en 1876, Mgr Bourget, démissionnaire, passait le flambeau à son successeur, et l'heure était aux querelles de succession, qui firent souvent le jeu du libéralisme. Les frères Archambault, chacun dans son domaine, ont participé à ce désordre. On vit par exemple Louis prendre sur lui de faire reconduire dans ses fonctions le chapelain de la Société Saint-Jean-Baptiste, au grand déplaisir de Mgr Bourget qui se réservait ce pouvoir. Au même moment, Urgel-Eugène se battait contre la politique de l'ultramontain Boucherville, qui voulait renforcer le monopole de l'Église sur l'enseignement, au détriment des enseignants laïcs...
 C'est dans ce contexte qu'était née la Société des Artisans canadiens-français, trois semaines à peine après la démission de Mgr Bourget.
C'est dans ce contexte qu'était née la Société des Artisans canadiens-français, trois semaines à peine après la démission de Mgr Bourget.
D'orientation franchement patriotique et religieuse – « pour la conservation de la langue, des traditions et de la foi » – l'organisation de la nouvelle société brisait avec l'amateurisme dans l'administration des affaires et avec la “ démocratie participative ” dans la direction, croyant ainsi mettre un terme aux divisions intestines et aux discussions oiseuses qui étaient le lot de presque toutes les mutuelles des débuts. Archambault voulait que la nouvelle société fasse preuve d'une crédibilité financière incontestable.
Si ce souci d'ordre et d'efficacité paraît bien légitime, il n'en demeure pas moins que les réformes apportées aux premiers principes du mouvement en modifiaient l'esprit. Archambault et ses amis avaient une mentalité d'affaires, qu'ils imprimèrent discrètement au mouvement, au détriment de la mentalité de coopérative. On commença par instaurer le contrat d'assurance, afin, disait-on, d'éviter les abus et le favoritisme. Puis on écarta de l'administration les membres non qualifiés, et le nombre des assemblées annuelles passa de six réunions théoriquement obligatoires, à deux réunions facultatives.
À ce compte, le simple ouvrier, ne se sentant pas utile, finit évidemment par se désintéresser totalement de l'administration de sa mutuelle, pour n'entretenir avec elle qu'une relation de pure consommation… comme dans une compagnie d'assurances, où les seuls intérêts particuliers de l'assureur et de l'assuré fixent les termes du contrat.
En 1888, les administrateurs décidèrent d'ouvrir les portes de la société aux gens de tous métiers et de toutes conditions, sous le légitime prétexte que les mieux nantis assureraient un revenu plus stable et apporteraient des compétences utiles pour l'administration… Sans doute, mais il est regrettable qu'elle n'ait pas pris des mesures pour empêcher ces nouveaux venus, mieux instruits, de prendre la direction de l'œuvre et d'en détourner la vocation ouvrière à leur profit.
À partir de 1891, elle commença à ouvrir des succursales dans les autres centres ouvriers de la province. Cependant, l'administration resta centralisée, et les succursales, privées de toute autonomie, ne purent garder le caractère familial de la mutualité des premiers temps.
En 1902, les administrateurs voulurent adopter les nouvelles méthodes d'assurance à l'américaine, édictées par le National fraternal congress (1886). On souhaitait donc adopter des taux fixes de cotisation, gradués selon l'âge à l'admission, afin d'encourager les gens à s'inscrire jeunes et en bonne santé. Mais c'était entrer dans la logique de la solvabilité actuarielle, autrement dit, la Société devait être en mesure d'honorer ses engagements à tout instant, et se préparer au pire. Il fallait donc “ calculer ” le pire, à l'aide des tables statistiques établies à cet effet par le National fraternal congress. Or, à ce compte, elle arrivait à ce constat effarant : sa réserve de 300 000 $ était insuffisante, il lui manquait… 1 200 000 $ !
Il fallut donc augmenter le capital financier et les taux de cotisation… et surtout, rechercher la clientèle plus “ solvable ” de la classe moyenne. On s'ingénia aussi à désavantager le régime d'assurance-maladie et de secours mutuels, si cher aux ouvriers mais peu rentable, pour privilégier celui de l'assurance-vie, plus spéculatif.
C'est ainsi que les sociétés fraternelles d'assurance-vie se transformèrent peu à peu en grandes institutions financières, répudiant tout caractère populaire et ouvrier, jusqu'à s'incorporer auprès du gouvernement canadien selon les termes légaux des compagnies d'assurance. Dans les années 1920, elles absorbèrent les dernières petites sociétés locales qui survivaient encore à la réforme. L'idéal de solidarité ouvrière des premières mutuelles avait vécu.
C'est infiniment regrettable, à l'heure où le développement accéléré de l'industrie réduisait les ouvriers à un véritable esclavage. D'autant plus que depuis les années 1860, le mouvement syndical naissant avait manifesté une collaboration franche et spontanée avec le mouvement mutualiste. Entretenue, mise à profit, et encore une fois dirigée par l'Église, cette collaboration aurait certainement modifié la question ouvrière telle qu'elle s'est posée au début du 20e siècle, en constituant une force capable de s'opposer efficacement à la concurrence des syndicats américains. Nous verrons, dans notre prochain chapitre, comment au contraire la faiblesse des mouvements catholiques entraînera les ouvriers dans une logique de lutte des classes.
RC n° 156, mars 2008